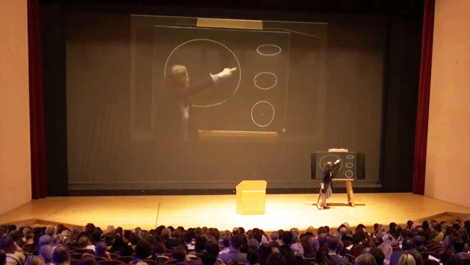Pourquoi l'enfant fait-il confiance à son enseignant ? Parce que celle-ci se tourne aussi bien vers l'enfant que vers le monde – en reconnaissant et en affirmant les deux. Cette double attention était pour Rudolf Steiner la base de la pédagogie - une condition sur laquelle l'apprentissage du monde et la participation au monde peuvent se développer. Lisez ici une version abrégée de l'article de Constanza Kalik dans «Das Goetheanum».
Plus d'homme, plus de monde : tel était le motif principal de la conférence d'ouverture de Josep Maria Esquirol à la World Teachers' Conference 2023 au Goetheanum. On y retrouve l'écho de ce qui a vécu pendant toute la réunion des éducateurs, des enseignants et des professeurs :
L'enfant est au centre et le monde est au centre – et les deux vivent simultanément dans la conscience de l'éducateur. Ce sont deux centres qui forment ensemble les deux foyers d'une ellipse de l'attention. L'attention pédagogique ressemble à un mouvement sur cette ellipse : une fois plus proche de l'enfant, puis plus proche des phénomènes naturels, d'une histoire, plus proche d'une équation mathématique, d'une découverte, plus proche de la richesse des phénomènes du monde.
Les enseignants peuvent développer un sens pour une telle proximité et pour une distance perceptive et attentive. Il s'agit d'une vision pressentie, tâtonnante, tournée vers l'enfant, vers l'homme en devenir, vers le nouveau citoyen du monde qui veut être concitoyen d'un monde commun.
Connaître, participer et devenir
Apprendre, c'est donc apprendre pour un monde commun. Nous nous savons communs, interdépendants, réciproques, uniques – avec tous les autres, qui sont également uniques. La connaissance de ce monde commun et la responsabilité à son égard constituent un terreau fertile pour la pédagogie ainsi que pour la société. Les questions d'éducation sont des questions sociales (sociétales).
Rudolf Steiner a formulé cette réalité de plus en plus visible dès le 20e siècle. Pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An 1922/23, il a donné le cours Le moment de l'apparition de la science de la nature dans l'histoire mondiale et son développement depuis lors. Ce cours ne s'adressait certes pas spécialement aux enseignants. Mais Steiner y évoque un tournant central pour les enseignants : le siècle qui voit naître la science moderne de la nature.
C'est le siècle qui se situe entre la Docta ignorantia de Nicolas Cusanus en 1440 et la publication du De revolutionibus orbium coelestium de Nicolas Copernic en 1543. Les développements qui ont suivi ces moments de naissance ont apporté aux hommes «des renoncements et des fécondations de la vie de l'âme». Une grande partie, voire la plupart, de ce que nous savons provient d'une perspective née à l'époque moderne : l'image de l'homme et de l'univers qui est à la base des sciences naturelles.
À partir du 15e siècle, on prend de plus en plus conscience que la Terre, en tant qu'objet, appartient à l'homme. A l'époque moderne, le monde est mesuré, le temps est ordonné. Les développements des sciences naturelles montrent l'homme dans son pouvoir et son désir de possession jusqu'à la prise de pouvoir et, au-delà, la destruction systématique. Quatre cents ans plus tard, le danger qui découle de ce pouvoir pour l'homme et le monde devient évident et existentiel.
Au 20e siècle, une autre forme de relation entre le monde et l'homme voit le jour. C'est une humanité sans emprise, une conscience croissante de la nécessité, une responsabilité pour les conditions de vie de la terre et de l'homme. Le philosophe Hans Jonas écrit que la dépendance n'est pas l'expression d'une privation ou d'une impuissance, mais d'un développement, d'une complexité et d'une différenciation. Il s'agit d'être vigilant et attentif à la connaissance de l'humanité menacée de l'homme, qui doit être protégée et soignée en tant que don prédisposé.
Pour ce nouveau départ, Rudolf Steiner développe la science de l'esprit anthroposophique. Dans ce tournant du 20e siècle, «plus d'homme, plus de monde» signifie autre chose que «plus de monde» au moment de la naissance des sciences naturelles. C'est une connaissance sans pouvoir, mais qui n'est pas impuissante face aux événements du monde. La connaissance devient une participation active au devenir du monde, au devenir de l'homme. C'est pour cette recherche de la connaissance, son développement, ses méthodes, son efficacité que Rudolf Steiner fonde l'École libre de science de l'esprit.
Sans l'autre, rien n'est possible
Ce qui est prioritaire, c'est une connaissance de l'homme, une image de l'homme comme base de la pédagogie : non pas comme mesure normative, mais comme orientation pour une «reconnaissance par le regard», pour l'apprentissage de la perception de l'unicité de l'enfant réel, de l'adolescent réel. La perspective d'un moi pour lequel l'autre et le monde sont des expériences constitutives et indispensables est déterminante. «Le moi est réel par sa participation à la réalité. Il est d'autant plus réel que cette participation est parfait.»
L'apprentissage a besoin de l'autre. Pour l'enfant, pour le jeune qui grandit, l'apprentissage est une réalisation dans la relation directe avec un autre être humain. Il s'effectue face à l'autre. Il a besoin de quelqu'un qui voit ce que je vois, à qui je peux montrer ce que je perçois, qui me montre ce qui est à voir, ce qui est à connaître, ce qui est à reconnaître. La beauté du monde se révèle dans le partage.
L'apprentissage repose sur la relation. Celle-ci change, évolue, est en mouvement. Les pédagogues reçoivent de la société la mission d'assumer la responsabilité des possibilités de la relation. Ils doivent transmettre la relation, la rendre possible et l'encourager. Pour cela, ils doivent eux-mêmes devenir «plus monde», plus humain. (...)
Constanza Kaliks
Traduction: deepl.com